 |
||
Guillaume & |
Les fortifications de Metz |
|
 |
L’histoire de la fortification de la ville de Metz a lieu du IIIe siècle jusqu’au XXe siècle. Elle s’étend sur plusieurs époques : antique, médiévale, moderne et contemporaine. Sous l’antiquité la ville de Metz s’appelle Divodurum Au départ, la vie se concentre sur la colline Sainte-Croix. En 52 avant J-C, les Romains ordonnent la construction d’un poste militaire qui s’agrandira avec les années. Il faut attendre le IIIe siècle pour que les premiers remparts de pierre voient le jour. Ils sont édifiés afin de faire face aux assauts des barbares. La ville s’entoure alors d’une grande enceinte percée de plusieurs portes. |
|
0. Agence Detectivarium
|
|
|
Durant les IXe et Xe siècles, les fortifications de la cité sont renforcées. En 1235, après de nouveaux travaux sur les remparts, l’enceinte mesure plus 6 kilomètres de long et compte trente-huit tours. Un siècle plus tard, la ville compte dix-huit portes dont la porte des Allemands, la porte Mazelle ou encore la porte Serpenoise. En 1445, une nouvelle opération de renfort est mise en œuvre. La fortification de Metz prend alors une orientation bien plus militaire et stratégique. |
||
À compter du XVIe siècle, les remaniements prennent une tournure radicale. La ville médiévale devient une place forte adaptée aux nouvelles technologies et l’artillerie. En 1675, Louis XIV envoie l’architecte Vauban en visite sur la place qui reconnaît l’importance de Metz. Louis de Cormontaigne poursuit le travail de Vauban. Plusieurs portes et remparts médiévaux sont démolis et remplacés par de nouvelles fortifications. À compter du XVIIIe siècle, les travaux voient naître de nouveaux bâtiments. Les remparts sont délaissés au profit de la construction de forts militaires. C’est aussi durant cette période que la première caserne est édifiée. On y loge l’infanterie. |

Dessin représentant les fortifications de Metz au XVIIe siècle (BNF, auteur inconnu) |
|
 |
Au cours du XIXe siècle, les progrès de l’artillerie obligent à de nouveaux travaux de renforcement. Une série de quatre forts est construite : à l’ouest de la ville les forts de Plappeville et du Saint-Quentin, à l’est, ceux de Saint-Julien et de Queuleu. |
|
 Caserne Bridoux au début du XXe siècle, l'une des nombreuses construite afin de renforcer la position militaire de Metz (auteur inconnu) |

Fort de Queuleu,bâtiment intérieur (Create common, auteur Juju939) |
|
Les vestiges de ces forts sont toujours visibles aujourd’hui, et pour certains des visites sont même possibles. |
||
|
La porte Serpenoise Ce monument est construit XIIIe siècle. Elle se trouve sur la voie romaine provenant de Scarpone, ville en amont de Metz. Elle fait partie intégrante des remparts de la ville. A cette époque elle n’est pas très impressionnante. Elle est finalement détruite en 1561 après avoir subi trop de dégâts après des affrontements. |
|
La tour camoufle Ce bâtiment fait partie d’une vaste manœuvre de renforts des remparts, la construction est lancée en 1437 sur les ruines d’une tour datant de l’époque gallo-romaine. Elle doit son nom à celui d’un bombardier messin du XVe siècle.
(creative common, auteur inconnu) |
 |
|
La porte des Allemands Elle est aujourd’hui le plus important vestige des remparts médiévaux messins. Elle doit son nom à des frères hospitaliers de Notre Dame des Allemands qui avait fondé un hospice. |
 Creative common, photo : Marc Ryckaert |
|
À compter de 1858, plusieurs vagues de restauration vont se succéder. |
||
 Vue de la Porte des Allemands (creative common, auteur : Marc Ryckaert)
Vue de la Porte des Allemands (creative common, auteur : Marc Ryckaert) |

Les tours de la porte des Allemands construite afin de favoriser la surveillance (creative common, photo : Marc Ryckaert) |
|
Le savais-tu ? Un fort de guerre est le plus souvent composé de plusieurs casernes et de blackhaus. Les murs des casernes font plus de deux mètres d’épaisseur. Ils sont souvent enfouis sous plusieurs mètres de terre et sous des chapes de béton. |
||
 |
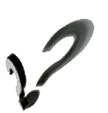 |
|
 Maquette de Divodurum (creative common, auteur inconnu)
Maquette de Divodurum (creative common, auteur inconnu) 